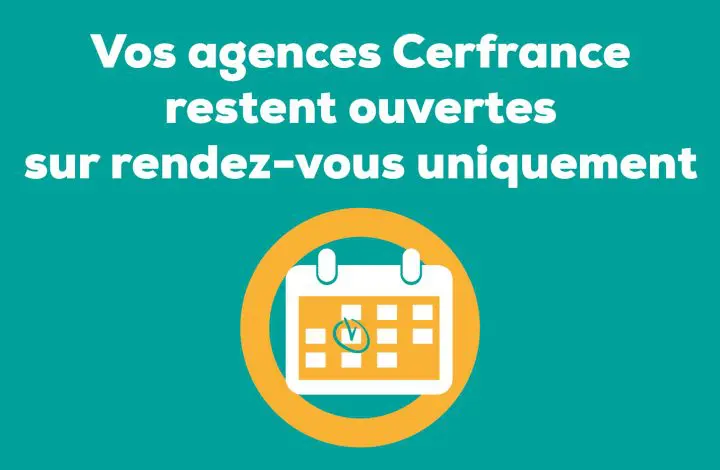Le confinement a été l’occasion de mettre en évidence les problèmes d’adaptation des producteurs face aux demandes des consommateurs.
Si l’engouement vers les aliments en provenance directe de la ferme n’a jamais été aussi intense que pendant cette période de crise sanitaire, il a aussi permis de constater certaines problématiques propres à ce système. Elles sont de plusieurs ordres :
- D’abord, en volume et en disponibilité. Chaque producteur a une capacité réduite à produire les quantités que les clients réclament. D’autant que la saisonnalité oblige à des ruptures de stocks, événements que les consommateurs ont largement oubliés, tellement habitués à trouver tout et tout de suite dans les grandes surfaces ! Les produits fermiers resteront longtemps des produits à volume réduit et à forte intensité de travail, donc plutôt onéreux. Mais ils n’ont jamais eu la vocation de concurrencer les produits premiers prix.
- Ensuite, la forte envie de consommer local a révélé l’inadéquation entre les zones de chalandises, notamment les aires urbaines, et la localisation des producteurs, souvent très éloignés des grandes agglomérations. Les producteurs sont peu organisés collectivement pour assurer l’acheminement de leur production. Certaines plateformes ont pris le relais pour tenter de combler ce manque mais les volumes concernés ont été très limités. Cette inadéquation est d’autant plus regrettable que nombre de producteurs de légumes ou de fruits n’ont pas pu commercialiser leur récolte en raison de leur éloignement des centres de consommation. Il en est de même pour des producteurs de fromages qui, en raison de la fermeture des marchés de proximité ou bien du fait qu’une partie de leurs ventes se réalisent à la ferme, n’ont vu aucun acheteur. L’approvisionnement de plateformes urbaines aurait pu être une alternative dont peu de producteurs ont profité du fait de leur faible organisation collective et de leur méconnaissance de ces circuits.
- Dans le prolongement des problèmes de logistique, des producteurs se sont trouvés débordés dans la gestion des commandes venues de nouveaux clients souvent éloignés de la ferme. Il a fallu, en catastrophe, gérer les envois de colis (Chronofresh a vu son activité en forte croissance). Nombre de producteurs n’ont pas répondu à ces commandes en raison notamment d’absence d’outil de paiement à distance. Trop peu d’exploitations en circuit court ont développé des sites internet, elles n’ont donc pas la possibilité d’utiliser les briques sécurisées de paiement à distance.
- Pour finir, la demande des clients urbains se décline vers des produits élaborés et cuisinés, notamment en fruits et légumes, voire en viande bovine (conserves, plats congelés…). Des produits prêts à consommer qu’ils ont l’habitude de trouver dans leurs supermarchés. Il y a un véritable gisement de chiffre d’affaires et donc de valeur ajoutée à capter pour les producteurs fermiers.
L’offre de produits de conserves de plats cuisinés fermiers est très limitée. Il faut dire que l’élaboration de plats est
un autre métier et les réglementations sanitaires peuvent décourager. Mais elle permet souvent de donner de la valeur à des matières brutes mal valorisées (défaut de calibre, surproduction en pleine saison…) ou pas stockables donc rapidement périmées. Il faut cependant régler le problème du laboratoire de transformation avec légumerie, autoclave et autres équipements qui ne peuvent dans un premier temps être accessibles que collectivement. La balle est dans le camp des collectivités territoriales et des collectifs de producteurs pour proposer des équipements qui vont véritablement ancrer les produits fermiers dans le panier de la ménagère.
C’est dans l’amélioration de ces quatre points que la crise sanitaire de la Covid-19 aura été bénéfique au développement
des circuits courts.
Jacques Mathé, économiste
Article issu du magazine Cerfrance « Gérer pour Gagner Agriculture » Août Septembre Octobre 2020 – Retrouvez l’intégralité du magazine dans votre espace client.