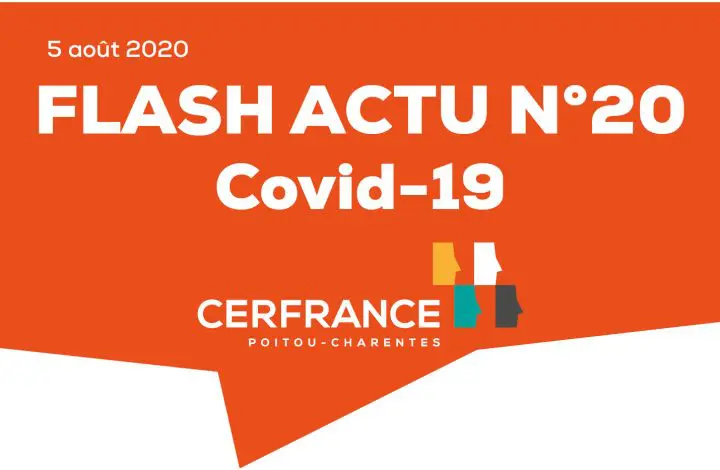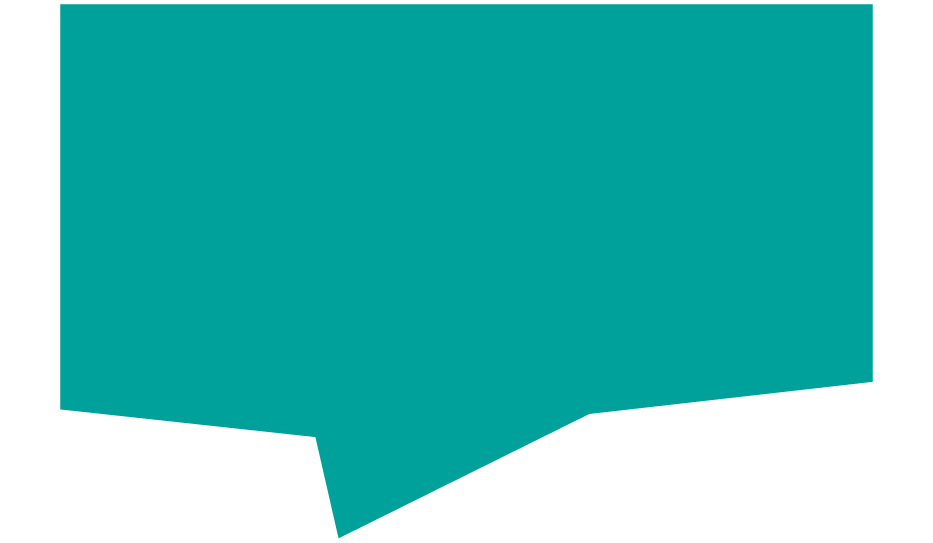Dépenses et charges : voilà des mots qui semblent simples à définir. Mais ce serait sans compter les subtilités du vocabulaire comptable. Si la notion de dépense est évidente, celle de charge l’est moins. Explications…
Des mots lourds de sens
Commençons par définir ces termes :
- la charge est une notion comptable, elle entre dans la composition du résultat de l’exercice ;
- la dépense est une notion de trésorerie, elle correspond à une sortie d’argents.
Seules les charges sont déductibles du bénéfice, c’est-à-dire de la base de l’impôt et des cotisations sociales pour l’entreprise individuelle.
Aussi, le décalage peut être important entre résultat comptable et situation de trésorerie. Par exemple, un stock mal
maîtrisé pèsera sur la trésorerie, mais ne diminuera pas le bénéfice imposable.
À l’inverse, une entreprise qui règle ses fournisseurs à 30 jours et qui encaisse ses ventes au comptant peut avoir l’illusion d’être à l’aise et ne pas s’apercevoir d’un problème de rentabilité.
Deux catégories de charges
Certaines charges sont variables : leur montant est directement lié à la production ou aux ventes de l’entreprise. Ce
sont, par exemple, les achats de fournitures et matériaux facturés au client, ou encore les marchandises destinées à la
revente.
À l’inverse, certaines charges sont fixes : il faut les couvrir quel que soit le niveau d’activité de l’entreprise. Ce sont les frais
généraux (tels que loyers, assurances, publicité, carburant, …) ainsi que les impôts et taxes, les charges de personnel,
les amortissements ou encore les intérêts d’emprunts.
La charge peut n’être qu’une partie de la dépense
C’est le cas pour les échéances d’emprunt : les remboursements effectués auprès de la banque sont la dépense liée à l’emprunt. Pour autant, comptablement, la charge d’emprunt correspond aux seuls intérêts remboursés.
Le capital n’est pas une charge puisqu’il s’agit du remboursement d’une avance. Ce qui coûte à l’entreprise, ce sont les intérêts.
La charge peut être calculée
Pour les investissements, la charge correspond à l’amortissement. C’est-à-dire
la somme qu’il faudrait mettre de côté chaque année pour renouveler le matériel qui se déprécie. Par exemple, un
tracteur acheté 70 000 €, avec une durée de vie de 7 ans, génère une charge
d’amortissement de 10 000 € par an.
Certaines charges ne sont pas visibles
Il s’agit par exemple de la rémunération du chef d’entreprise individuelle. En société, la rémunération du gérant
est une charge déduite du bénéfice (bien que réintégrée fiscalement pour une société à l’impôt sur le revenu).
Pour l’entrepreneur agricole individuel, ses prélèvements personnels sont une dépense, mais pas une charge déduite
du bénéfice. Ils n’apparaissent donc pas dans le compte de résultat, bien qu’ils constituent des sommes supportées par l’exploitation.
La charge n’est pas forcément une dépense
Pour être qualifiée de charge, une dépense doit être facturée et/ou rattachable à l’exercice. Par exemple, des marchandises facturées et payées mais qui figurent en stock ne seront pas comptabilisées en charge de l’exercice car elles ne seront revendues que sur l’exercice suivant. À l’inverse, des marchandises achetées et revendues sur l’exercice seront comptabilisées en charge même si la facture n’est pas réglée.
Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise
Article issu du magazine Cerfrance « Gérer pour Gagner » Mai Juin Juillet 2020 – Retrouvez l’intégralité du magazine dans votre espace client.