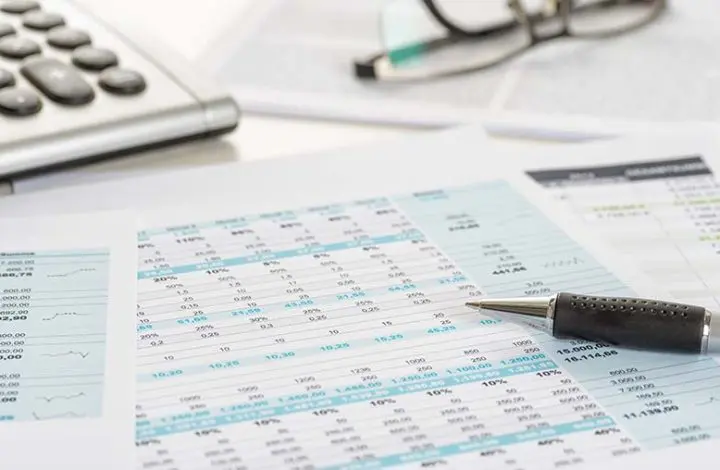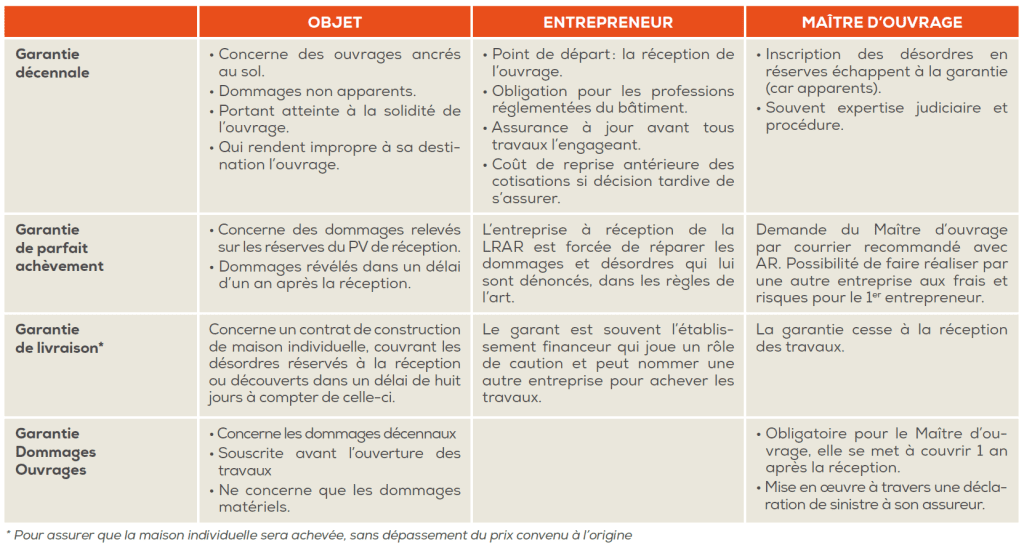Vous avez besoin de renforcer les capitaux propres de votre entreprise en période de crise sanitaire. Pourquoi ne pas envisager la réévaluation libre du bilan ? On vous explique !
1. Un dispositif déjà existant…
Avant de décrypter les nouveautés, rappelons que la réévaluation du bilan est un dispositif déjà existant, qui porte obligatoirement sur l’ensemble des actifs corporels et financiers que possède l’entreprise. Il lui permet d’inscrire à son bilan leur valeur réelle de marché.
L’écart constaté entre la valeur actuelle de l’immobilisation et sa valeur telle qu’elle figure au bilan sera directement inscrit dans les capitaux propres et aura donc pour effet d’augmenter l’actif net de l’entreprise.
Du point de vue de la fiscalité, cet écart de réévaluation constitue un profit exceptionnel imposable immédiatement.
Toutefois en présence de déficits reportables, le produit exceptionnel sera réduit.
Par ailleurs, pratiquer une réévaluation des immobilisations en actualisant leur valeur à la hausse conduit, en contre partie, à pratiquer des amortissements plus importants sur les années suivantes et, par voie de conséquence, à réduire le bénéfice imposable.
L’impact de la taxation immédiate du profit, lié à la revalorisation des actifs de l’entreprise, peut être dissuasif dans la mesure où il intervient sur un seul et même exercice. L’entreprise ne dispose pas forcément de la trésorerie suffisante pour lui permettre de payer l’impôt correspondant.
2. … Actualisé au regard de la pandémie
La loi de Finances pour 2021 est venue assouplir ce régime dans un contexte de crise sanitaire : pour une période limitée dans le temps, et sur option, les entreprises qui procéderont à une réévaluation d’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières pourront différer l’imposition de la plus-value constatée.
Les immobilisations non-amortissables pourront donc bénéficier d’un régime de sursis d’imposition des écarts d’évaluation jusqu’à leur cession ultérieure.
Concernant les immobilisations amortissables, l’entreprise devra réintégrer l’écart de réévaluation dans ses bénéfices imposables par parts égales, sur une durée qui varie selon la nature des immobilisations :
- 15 ans pour les constructions, plantations, …
- 5 ans pour les autres immobilisations (véhicules, machines, équipements).
L’option de réévaluation, sous couvert du dispositif de faveur, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Attention : un état de suivi devra être établi annuellement jusqu’à la complète réintégration du profit exceptionnel.
Focus :
Que se passe-t-il si l’entreprise cède l’immobilisation amortissable avant la fin de la période de réintégration ?
Dans ce cas, la fraction non encore réintégrée à la date de la cession deviendra immédiatement imposable. La loi de Finances précise également que les amortissements, provisions et plus-values ultérieures relatives aux immobilisations amortissables, seront
calculés d’après leur valeur issue de la réévaluation.
Exemple : Monsieur Lavaleur a une entreprise de prestations de services. Son dernier résultat déficitaire a entraîné une perte de plus de la moitié du capital de sa SARL.
Avec son comptable, il est décidé de réaliser une opération de réévaluation libre de son bilan au 31 mars 2021. Cela concerne notamment un matériel acheté 8 000 €, qui figure au bilan en valeur nette comptable pour 2 000 € alors qu’il est estimé 4 000 €. La revalorisation de ce bien pour 4 000 €, qui seront inscrits à l’actif du bilan, conduit à constater un écart de réévaluation de 2 000 €.
Du fait de l’application du nouveau dispositif, cet écart n’est pas imposable au niveau du résultat 31/03/2021 mais il sera étalé sur 5 ans de 2021 à 2025 soit 2 000 € / 5 = 400 € sur chaque exercice pendant 5 ans.
En contrepartie, le bien sera réamorti sur sa durée d’utilisation estimée à 5 ans sur la base de 4 000 €. Si Monsieur Lavaleur cédait ce bien au 1er avril 2024 au prix de 6 000 €, l’entreprise aurait déjà réintégré 1 200 € (= 3 x 400 €) au titre de l’écart de réévaluation.
Entre le 1er avril 2021 et la date de cession en avril 2024, Monsieur Lavaleur a également constaté 2 400 € d’amortissement.
Au titre de la cession, la plus-value sera égale à 4 400 €, soit 6 000 € (prix de cession) – 1 600 € (valeur nette comptable après amortissement sur la base des 4 000 €).
Le solde de l’écart de réévaluation non encore réintégré (2 000 € – 1 200 € = 800 €) sera immédiatement imposé.
Noëlle Lecuyer, responsable juridique
Article issu du magazine Cerfrance « Gérer pour Gagner » Mai Juin Juillet 2021 – Retrouvez l’intégralité du magazine dans votre espace client.