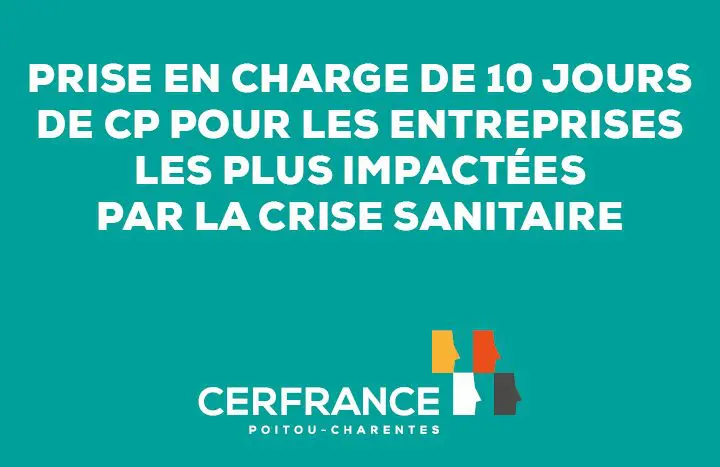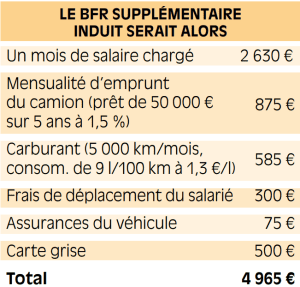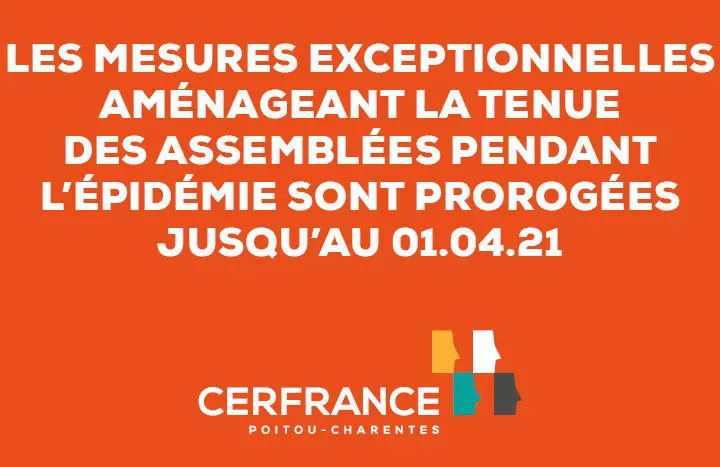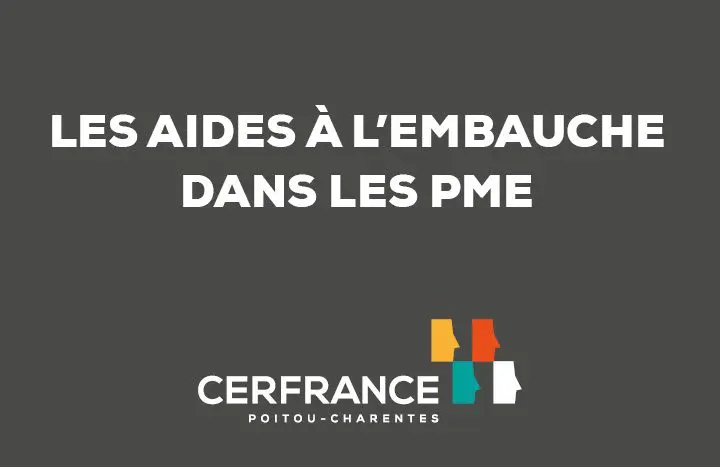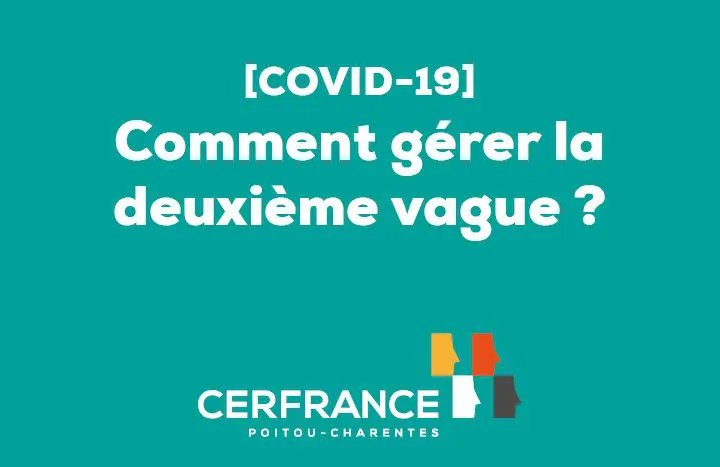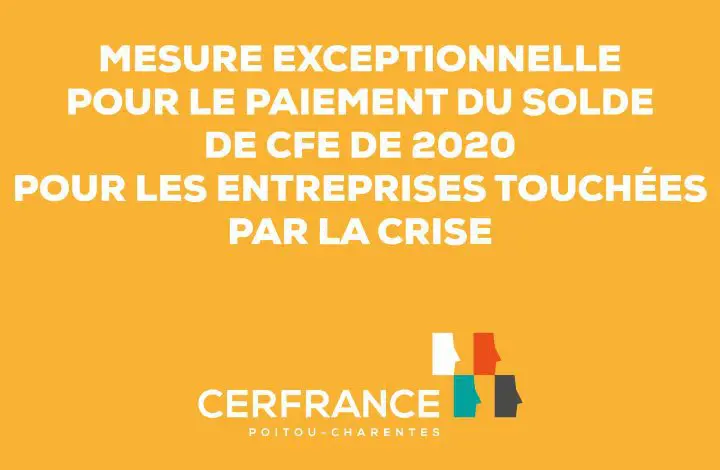L’État va prendre en charge jusqu’à 10 jours de congés payés pour soutenir les entreprises les plus durement touchées par les deux confinements lors de la crise sanitaire de 2020.
Il s’agit des entreprises qui ont fait l’objet de fermetures administratives sur une grande partie de l’année 2020, principalement celles du secteur de l’évènementiel, des hôtels, des cafés, des restaurants, des discothèques, des salles de sport…
Afin d’apporter un soutien aux professionnels qui rencontrent des difficultés pour faire face aux congés payés accumulés en période d’activité partielle, le Gouvernement a retenu une aide économique ponctuelle et non reconductible ciblée sur les secteurs très impactés, avec des fermetures sur une grande partie de l’année 2020.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises devront répondre à l’un ou l’autre des critères d’éligibilité suivants :
- L’activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
- L’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.
Ces deux seuils permettent de rendre notamment éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels qui n’ont pas été administrativement fermés mais qui ont été contraints à la fermeture par manque de clients dans les périodes de restriction des déplacements.
Elle concernera aussi les secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors qu’ils rentrent également dans ces critères.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021. Cela nécessite pour les employeurs de s’organiser dès à présent pour respecter le délai de prévenance de 30 jours et réunir le CSE quand cela est nécessaire.
Les congés payés devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période. Pour le versement de cette aide, le Gouvernement utilisera les circuits de paiement de l’activité partielle via l’Agence de services et de paiement (ASP).
Source : economie.gouv.fr