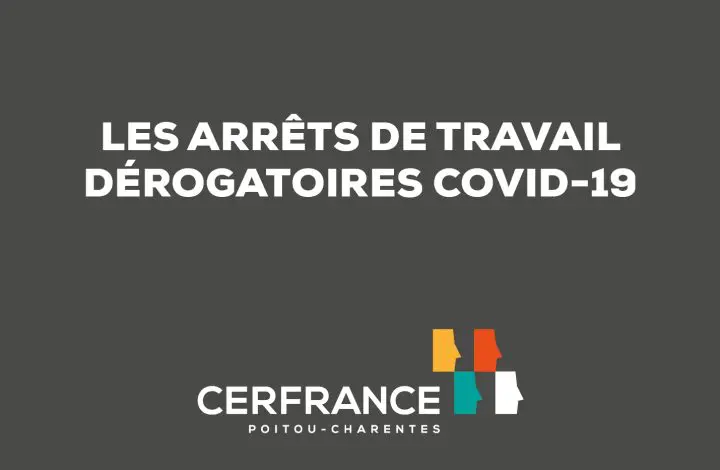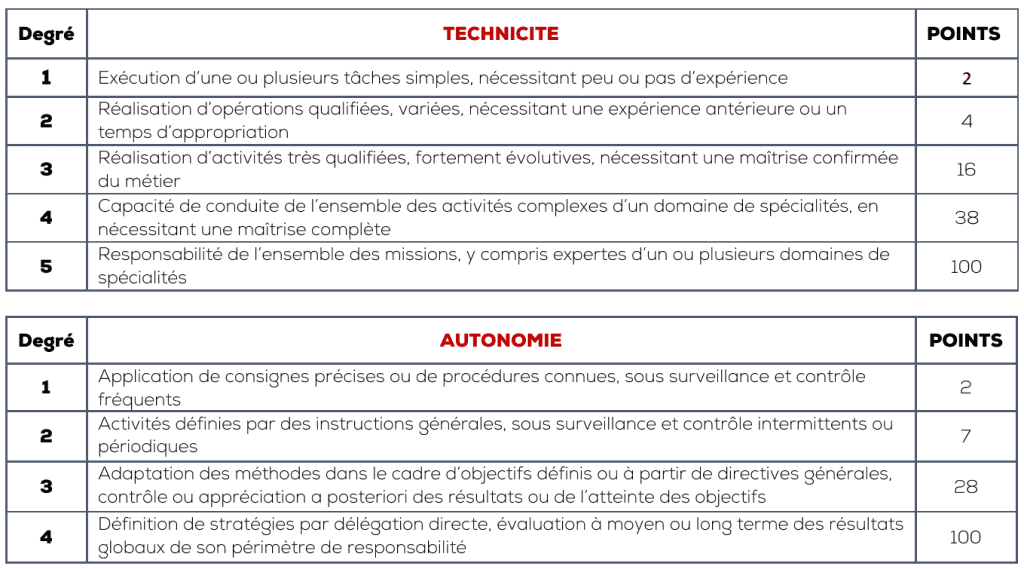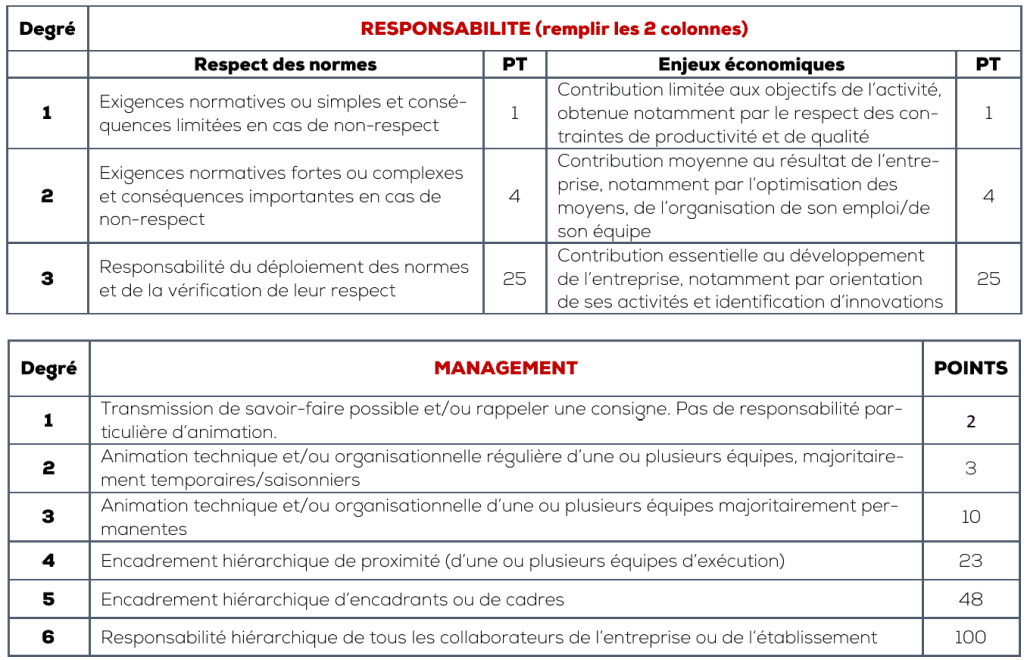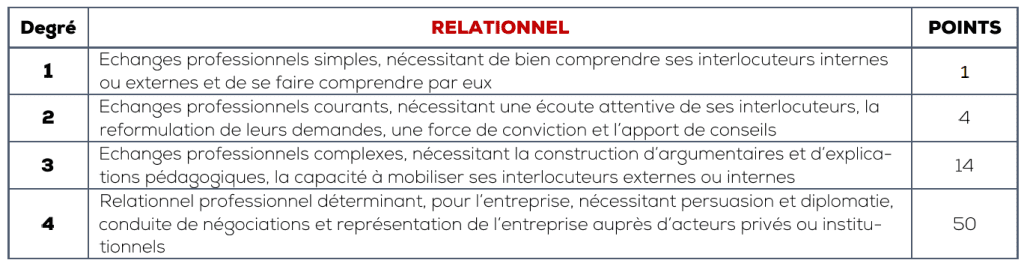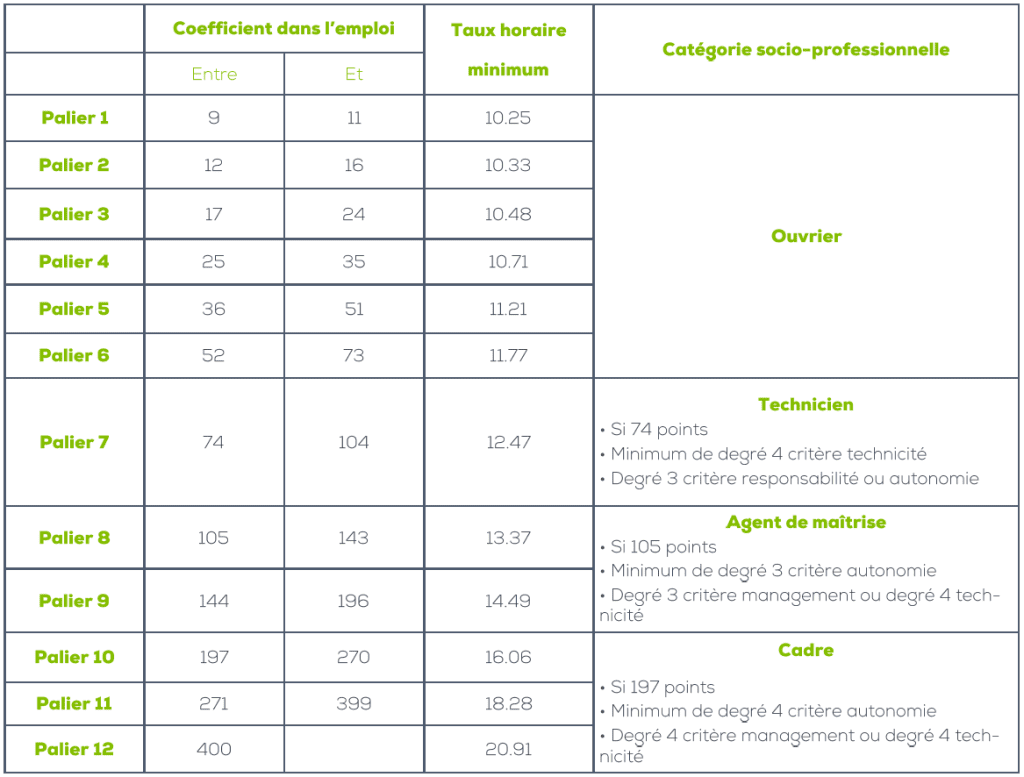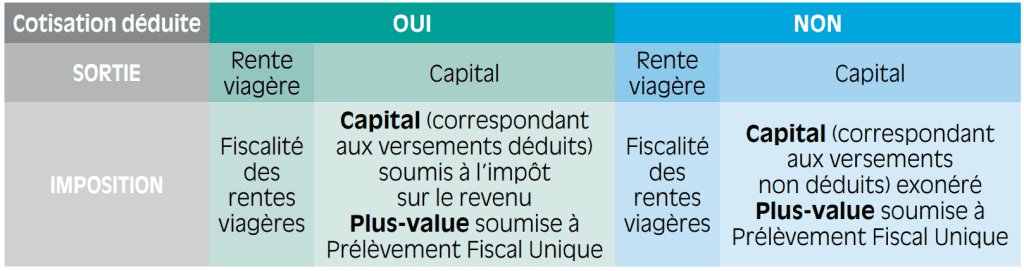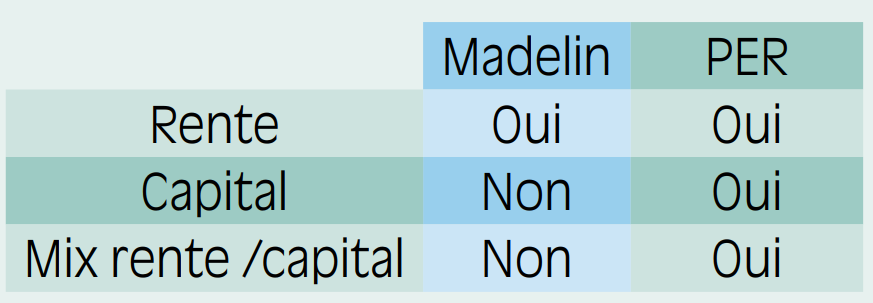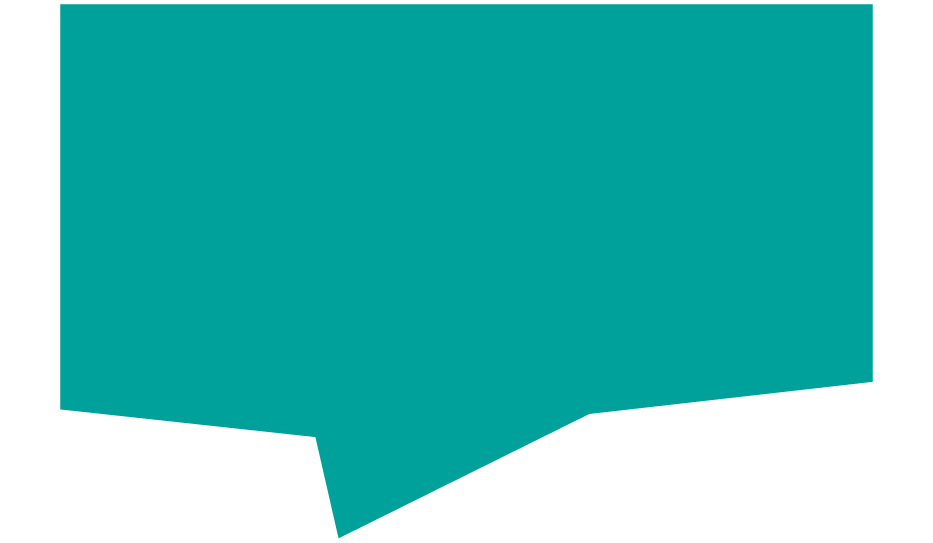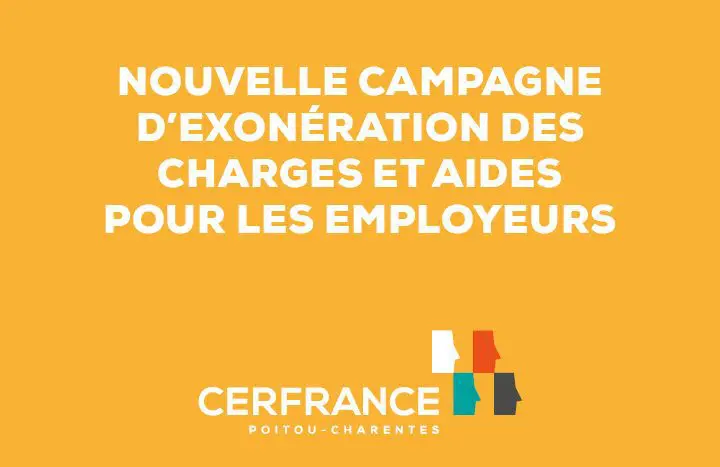La transition écologique apporte de nouvelles trajectoires et de nouveaux marchés pour le monde agricole. Elle encourage l’innovation et les esprits entrepreneurs. Cependant, tout changement engendre des incertitudes et un temps nécessaire d’adaptation ; la transition écologique ne fait pas exception en la matière. Afin de la réussir et d’en limiter les coûts cachés, il est nécessaire de bien l’anticiper et d’en mesurer ses risques.
La transition écologique et énergétique s’inscrit dans une évolution de la conduite des exploitations avec toutes les incertitudes que cela comporte. D’un point de vue économique, ces incertitudes proviennent, d’une part, des bénéfices escomptés en termes de meilleure valorisation des productions ou des économies dans les facteurs de production et, d’autre part, des coûts nouveaux à engager (travail du sol, aménagements des bâtiments) et des coûts cachés (temps de
travail rallongé, augmentation des coûts unitaires de production).
Les coûts vont souvent provenir d’un défaut d’anticipation et de maîtrise des changements de pratiques. Pour les limiter, la formation, l’expérimentation à la ferme, la patience et le changement des paramètres “du logiciel technique” de chaque agriculteur sont des passages obligés. Impossible de faire du copier-coller de parcours techniques, processus qui a si bien fonctionné pendant cinquante ans. “Avec ce concept, c’est bien d’innovation, gourmande en savoirs, en technologies et en changements organisationnels, dont on parle, et non d’un retour à une agronomie ancestrale. L’agro-écologie mobilise les régulations biologiques au sein des parcelles et des territoires pour permettre à la fois la gestion des bioagresseurs et une meilleure disponibilité des éléments fertilisants” rappelle Christian Huyghe, Directeur scientifique de l’INRA.
L’agriculture de recettes s’adapte mal à l’agro-écologie car cette dernière s’appuie d’abord sur l’observation et les caractéristiques locales de chacune des fermes. En contrepartie, les productions issues de ces fermes vont bénéficier d’atouts nouveaux (caractéristique locale, niveau gustatif, image du produit) qui étaient peu reconnus dans une agriculture de volume.
Les bénéfices de la transition écologique vont aussi concerner des débouchés nouveaux que ce soit dans les filières alimentaires ou non alimentaires (production énergétique, matériaux biosourcés…). N’oublions pas que les opportunités nouvelles peuvent aussi s’additionner avec une économie des coûts de production liée à la diminution des intrants ou à l’autonomie alimentaire des troupeaux.
Enfin, des soutiens publics par le biais de la PAC, mais aussi par les collectivités territoriales, peuvent compenser les coûts cachés ou la baisse de la productivité. De même, les pouvoirs publics interviennent en apportant des subventions pour certains investissements qui permettent de réduire les émissions de carbone (aménagement des bâtiments, formation aux pratiques d’économie d’énergie…).
Si la performance environnementale de l’agriculture bénéficie à l’ensemble de la société, on voit mal les agriculteurs en supporter à eux seuls les coûts d’adaptation.
Jacques Mathé, économiste
Article issu du magazine Cerfrance « Gérer pour Gagner » Novembre Décembre 2020 Janvier 2021 – Retrouvez l’intégralité du magazine dans votre espace client.