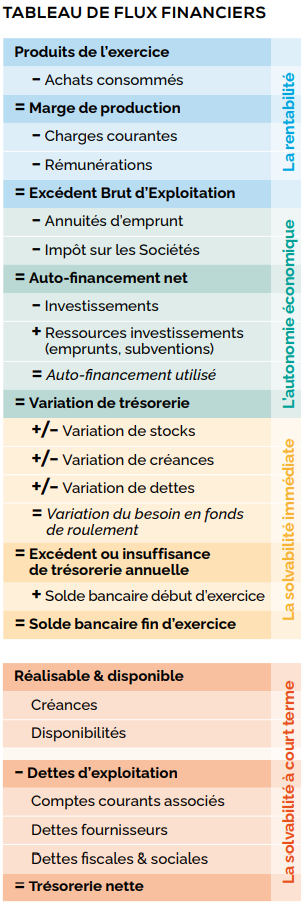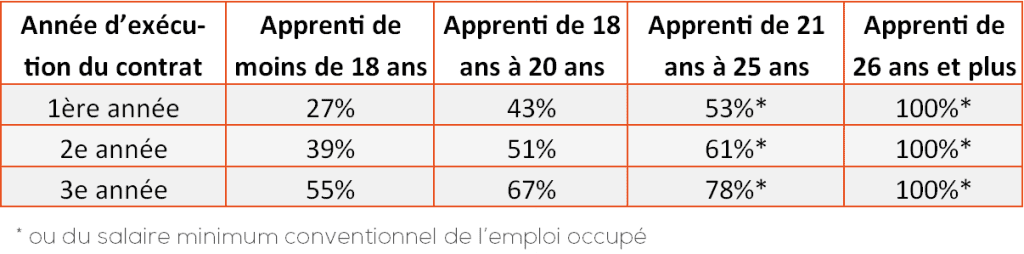Les termes liés à la transformation numérique qu’il est intéressant de connaître
Batch Streaming : Le batch désigne en informatique l’automatisation d’une suite de commandes exécutées en série sur un ordinateur sans qu’il soit nécessaire qu’un opérateur intervienne pour réaliser cette opération. On le traduit la plupart du temps par le terme « lot » en français et par l’expression « traitement par lots ». Le programme est autonome. Le traitement par flux correspond à la partie streaming process, en flux constant sans séparation par lots et à leur arrivée.
Big data : Désigne des ensembles massifs de données que les entreprises doivent traiter mais qui demeurent difficiles à travailler de par le volume qu’elles représentent. Elles sont composées d’indicateurs, tendances, connaissance clients, déclarations ou communications.
Blockchain : Une technologie de stockage et de transmission d’informations, constituée en base de données sécurisée contre la
falsification. Véritable chaîne de blocs de données validées par un algorithme elle constitue un système décentralisé transparent. Peut être vue comme un grand livre de compte qui vérifie et regroupe toutes les transactions passées. Dans les transactions en
bitcoin ou dans des contrats, cette blockchain peut intervenir comme un intermédiaire de confiance.
Cloud : Littéralement le nuage est l’exploitation de la puissance de calcul et de stockage de serveurs distants par l’intermédiaire d’un réseau, généralement sur internet.
Cryptomonnaie : Il s’agit d’une monnaie utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair. Elle est fondée sur
les principes de la cryptographie et intègre l’utilisateur dans les processus d’émission et de règlement des transactions. (ex : bitcoin).
Data Lake : Ce terme de Lake (lac) désigne un type de base de données, qu’elles soient dites structurées ou non structurées
et dans tous les formats possibles. Les données contenues dans ce data lake sont libres et c’est à l’utilisateur de créer la structuration qu’il souhaite.
Data Mining : Exploration de données, prospection de données, la data mining, se conçoit comme une extraction de connaissances
à partir de données, d’un savoir à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques (utilisation d’un ensemble d’algorithmes en IA, statistiques par exemple).
Deep Learning : Lié au Machine learning, il se traduit par l’apprentissage en profondeur selon les multi-couches d’un système (3). Encore aux balbutiements, il se développe de plus en plus et notamment par les géants du web tels que Google et Facebook.
Gateway : Ou littéralement « passerelle » est un dispositif permettant de relier deux réseaux distincts présentant une topologie différente.
IA : L’Intelligence Artificielle est un ensemble de techniques, technologies, méthodes qui est destinée à simuler un comportement humain dans une machine. La raison d’être étant d’apprendre et se corriger pour réaliser des tâches.
IoT : Abréviation pour Internet of Thing soit internet des objets, qui représente les échanges d’informations et de données provenant de dispositifs présents dans le monde réel vers le réseau internet. Le cabinet d’analyse IDC indique que les entreprises ont consacré pas moins de 726 millions de dollars dans ce domaine en 2019, et prévoit que les achats IoT atteindront 1,1 billion de dollars en Le taux de croissance annuel entre 2019 et 2023 sera de 12,6%.
Machine Learning : Le contexte d’un ordinateur qui n’aurait pas toute la préprogrammation, car considéré comme auto-apprenant.
De plus en plus favorisée l’IA se concentre sur ces machines learning pour déployer des algorithmes auto-apprenant. C’est la quantité considérable de données (big data) qui favorisent le développement de ces algorithmes.
Objets connectés : Dispositifs matériels ayant la capacité d’envoyer, en temps réel ou non des données captées sur son état ou son
environnement à partir d’outils de mesure, ou d’être sollicité à distance pour effectuer une action particulière.
Open Data : Caractéristique d’une donnée dite ouverte, donc accessible à tous. Une partie de ces données disponibles sont réutilisées dans les analyses approfondies et mélangées à des données privées puis stockées dans une base de données.