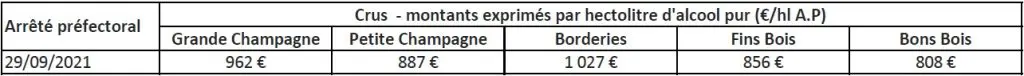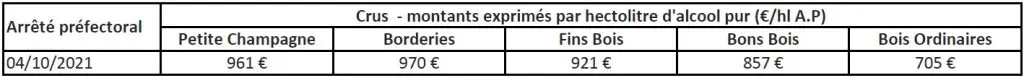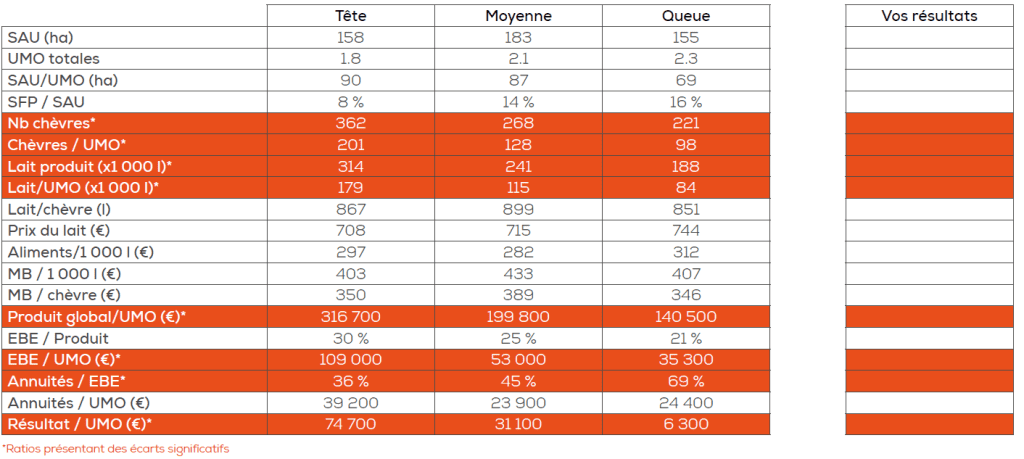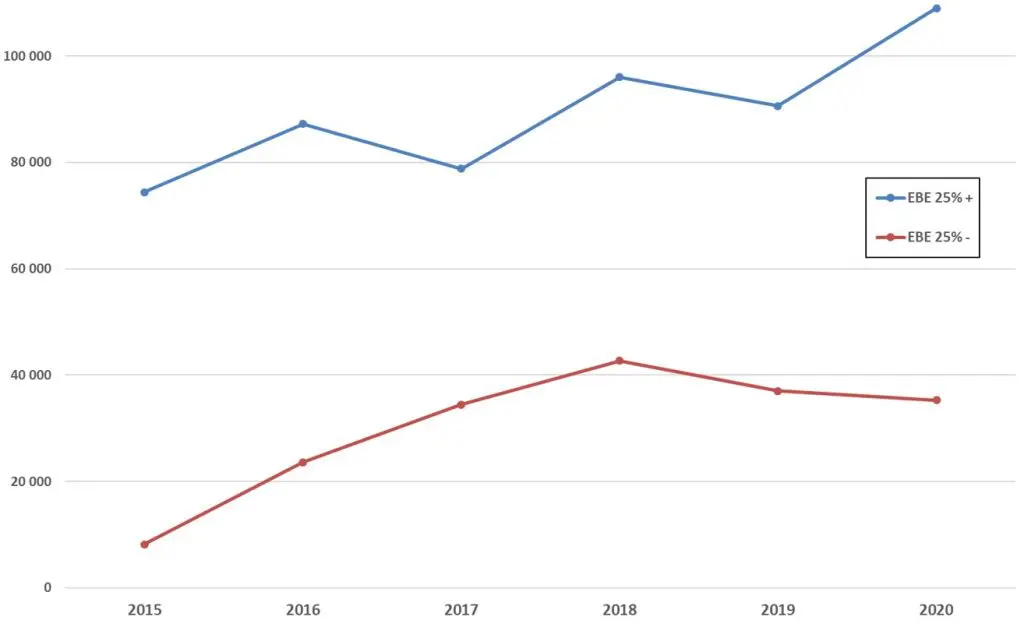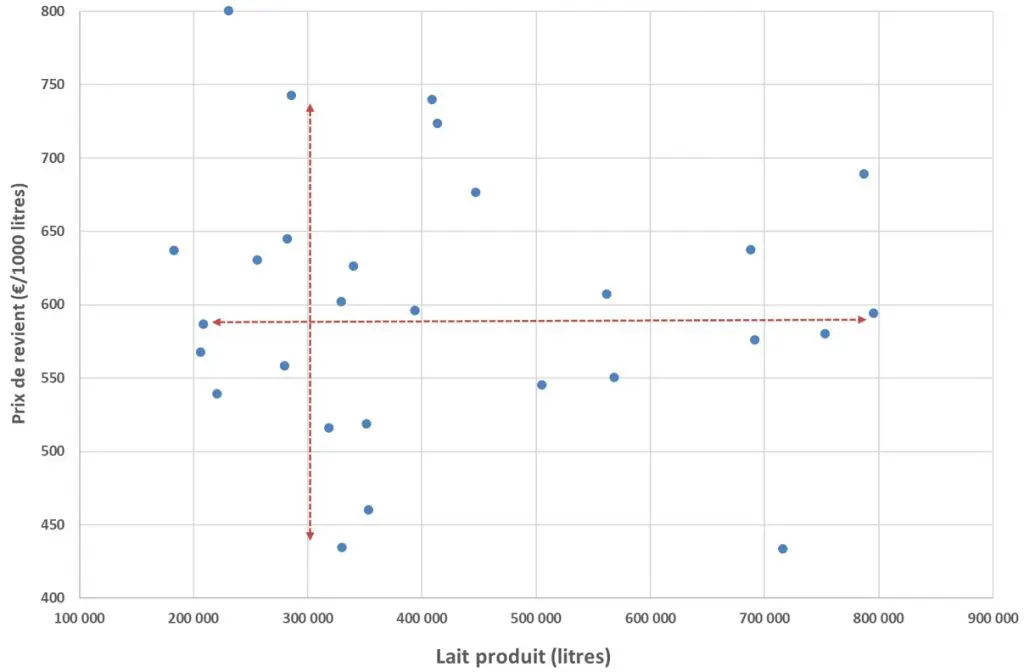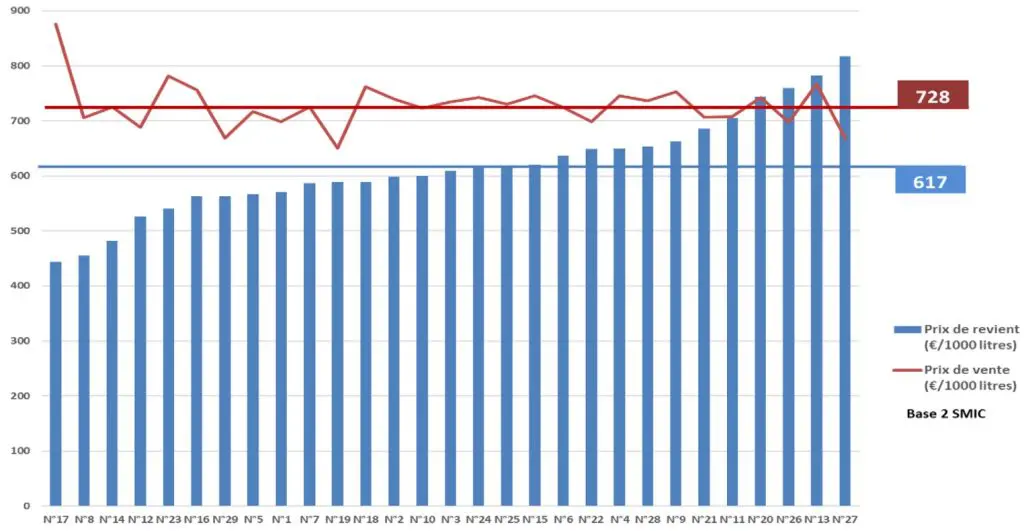Premier pilier : poursuite des Aides surfaciques, à l’hectare de SAU
Autre précision importante qui me fait dire que c’est vraiment une PAC de transition. Il est dit et rappelé que, pour la France et pour les agriculteurs français, il y a une forme de tunnel si on fait le parallèle avec ce qui vaut dans certaines filières et dans certains marchés. En ce sens que cette PAC ne doit pas représenter une variation de plus de 4% du montant global des aides pour un agriculteur par rapport au cycle de la PAC précédente. J’ai parlé de changement dans la continuité, donc en matière de continuité, par exemple, on ne change pas la structure, la colonne vertébrale. On a toujours des aides et une PAC structurée, bien ancrée sur ses deux pieds. Autrement dit, deux piliers. Un premier pilier, des aides économiques, des aides directes qui restent, des aides surfaciques qui seront dévolues à l’hectare de SAU et, en parallèle, un second pilier, le pilier dit du développement rural, avec des aides dites environnementales. Premier pilier dominant en termes de budget, majeur pour toute exploitation agricole française. On est sur un budget annuel de l’ordre de 6,7 milliards d’euros, une baisse puisqu’on était plutôt actuellement sur 6,9 à 7 milliards. Et un second pilier pour lequel on voit bien l’orientation climato-compatible en devenir. Un second pilier qui, lui, est plutôt plus abondé. On passerait de 2,3 milliards à 2,6 milliards environ. On frôle les 10 milliards d’aides annuelles pour la France. On est à 9,3 / 9,5 milliards.
Je m’arrête sur le premier pilier pour dire d’abord, il y a des constantes. Il y a des choses qui ne bougent pas, au moins en volume. C’est le cas, par exemple, des aides couplées qui vont représenter 15% du budget du pilier. Ça demeure, comme pour l’ancien tronçon, avec un accent qui est mis en faveur des protéines végétales. C’est dans l’air du temps et légèrement au détriment, à enveloppe constante, des aides animales qui seront un peu minorées au fil du temps en s’orientant vers 2027. Ces aides animales, rien de neuf sous le soleil s’agissant des aides ovines & caprines. En revanche, les aides aussi bien à la vache laitière qu’à la vache allaitante sont fondues dans un mix d’une aide unique à l’UGB, dite de plus de 16 mois et évidemment, qui se veut incitative, choix de la France pour favoriser l’engraissement sur le territoire national.
Une aide JA qui est plus valorisée au niveau de ce premier pilier avec la notion d’aide forfaitaire.
Également le Droit à Paiement de Base (DPB). On va donner la lecture de tous les sigles à chaque fois le fameux DPB qui devient l’ABR (Aide de Base au Revenu), légèrement majoré également. Voilà pour ce tour de stabilité sur certains niveaux de mesures.