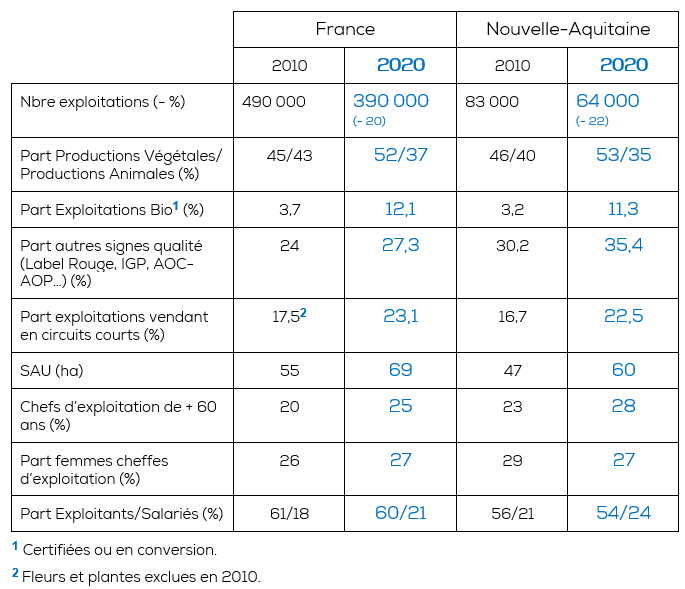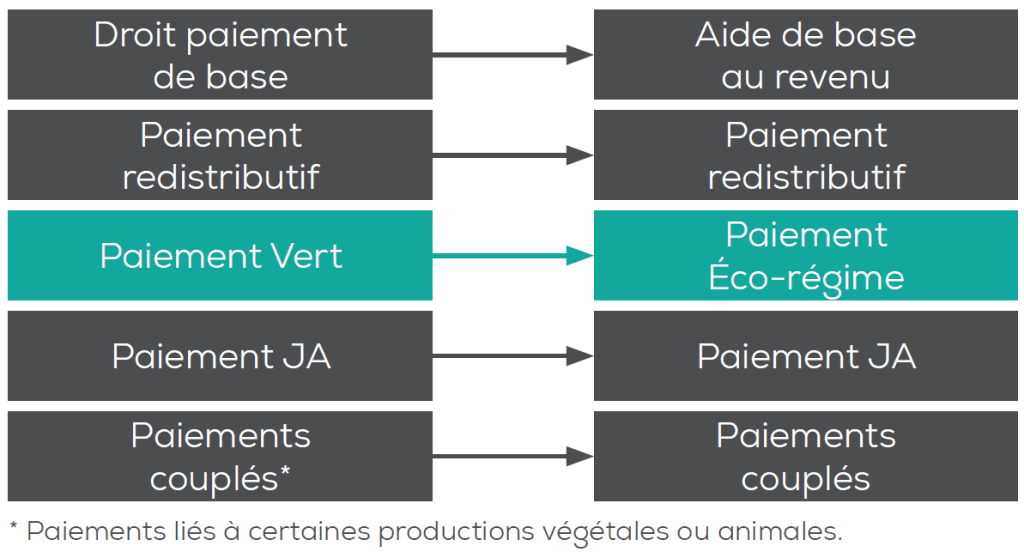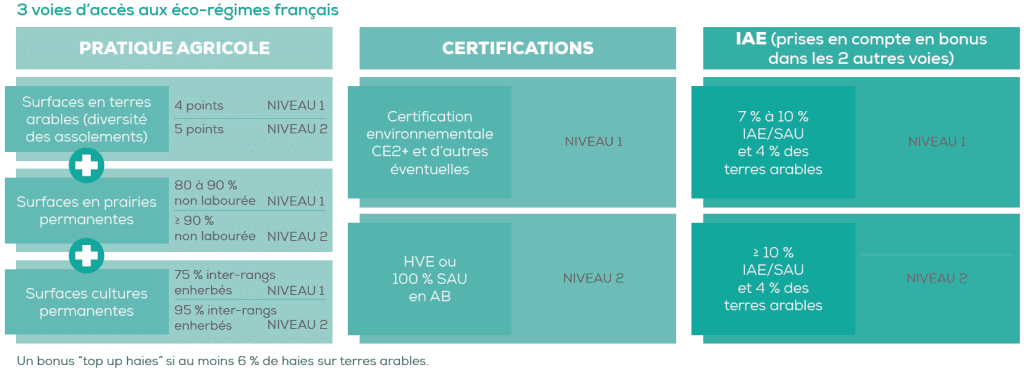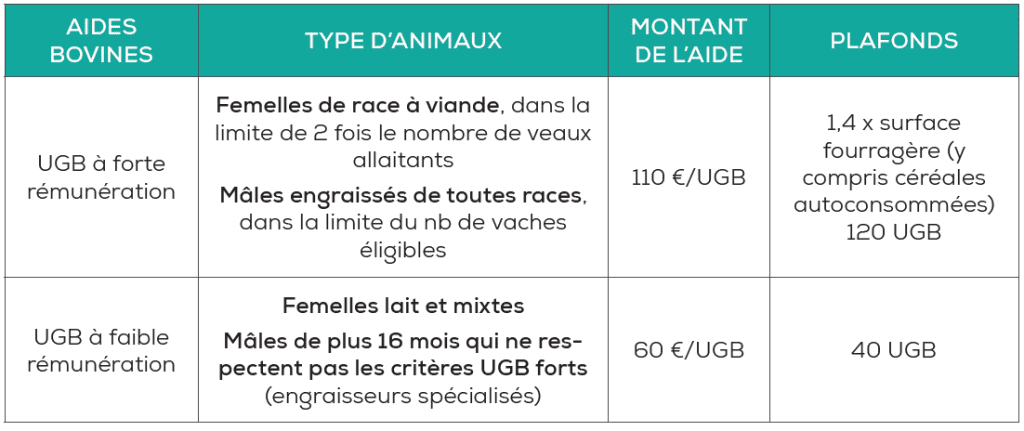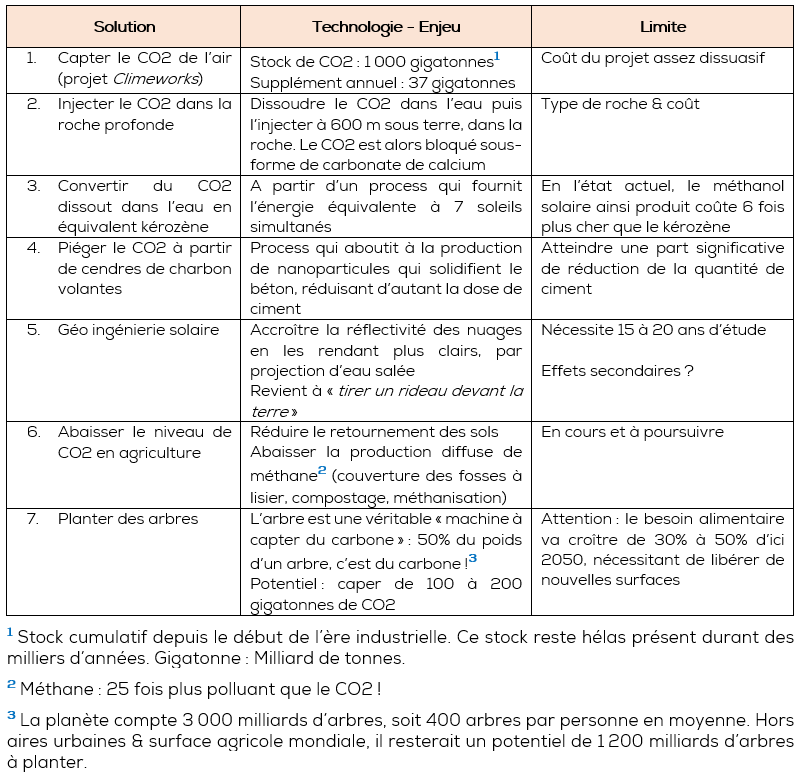L’UE : un bon élève trop isolé à respecter les règles de libre-échange
Entre grands de ce monde, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce – 164 membres. A succédé au GATT en janvier 2015) est, en théorie tout du moins, l’organe sensé édicter les règles commerciales en vigueur pour ses 164 Etats membres.
A l’heure du 20e anniversaire de l’adhésion de la Chine, un observateur avisé (Christian CHAVAGNEUX, éditorialiste à Alternatives Economiques) en dresse un bilan peu glorieux pour l’UE ;
- en 20 ans, la Chine a vu son PIB par habitant et par an passer de 1 000 $ à 10 000 $,
- quant aux USA, ils contournent régulièrement les règles de l’OMC en nouant des accords bilatéraux afin d’organiser leur propre protectionnisme,
- en 20 ans, ce sont 360 entreprises européennes qui ont été rachetées par la Chine,
- la Chine et les USA sont deux empires qui se comportent comme des puissances impériales,
- l’UE, c’est l’idiot du village, le bon élève qui s’emploie à respecter les règles de libre-échange…
Pour bien cerner les « forces de frappe » respectives, prenons deux cas concrets.
Les Chinois organisent les « routes de la soie » : la Chine finance & impose ses structures ferroviaires à 49 pays (Afrique, Asie, Amérique Latine). Dès lors, quand on a fixé l’écartement des rails à sa mesure, on devient à l’évidence incontournable commercialement parlant (!)
L’UE, quant à elle, se targue d’investir dans le cloud, le numérique. Investissement de 10 milliards d’euros seulement, et en 7 ans… C’est précisément ce qu’investit Amazon en un petit trimestre.
Nous -Europe- avons pris un train de retard en termes de politique industrielle, de recherche & développement comme de standards mondiaux.
Et si le match n’était pas plié ? Certains observateurs se montrent optimistes à l’heure où l’UE va par exemple devoir construire un mécanisme d’ajustement Carbone à ses frontières, lequel entrera en vigueur au 1/01/2026. Or, il est de notoriété publique que la Chine fait partie des gros pollueurs de la planète.
Suite au prochain épisode…